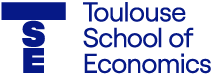L'impact des subventions d'innovation auprès des grandes entreprises est généralement très faible. Pour l'améliorer, Frédéric Cherbonnier conseille de s'inspirer de la "logique de mission" mise en place aux Etats-Unis. Les entreprises européennes consacrent deux fois moins de ressources à innover que leurs concurrentes américaines. En outre, selon le rapport "How to escape the middle technology trap" rédigé par plusieurs économistes dont le prix Nobel français Jean Tirole, ces activités de recherche et développement (R&D) portent majoritairement en Europe sur des industries de technologie intermédiaire (comme l'automobile) où l'innovation est incrémentale et peu susceptible de générer des avancées significatives. À l'inverse, 85 % de la recherche des entreprises américaines concernent des industries de haute technologie, notamment le logiciel et la pharmacie.
Ceci s'explique en partie par la fragmentation de l'Europe avec 27 réglementations distinctes du travail et des marchés de capitaux nationaux. Mais les pouvoirs publics sont également en grande partie plus directement responsables de cette situation. Dans tous les pays développés, les administrations consacrent une part significative de leur budget à soutenir les entreprises dans leur effort de R&D afin de pallier les imperfections de marché qui limitent le financement et la rémunération de ces activités risquées. La France est d'ailleurs championne en la matière, en consacrant plus de 0,4% de son PIB à des subventions et à des incitations fiscales en faveur de la recherche en entreprise. Il est essentiel que cette dépense publique ait un réel impact. Les travaux économiques montrent que l'impact des subventions auprès des grandes entreprises est généralement très faible, et que les incitations fiscales ont juste un effet additif - 1 euro public induit 1 euro de R&D supplémentaire. Idéalement, on souhaiterait obtenir davantage, avec un réel effet d'entraînement sur la R&D, et ce sur les secteurs technologiques d'avenir.
Comment choisir efficacement les projets à financer? Une première approche consiste à laisser les chercheurs et entreprises libres de choisir leur projet, lequel est retenu s'il est validé sur le plan scientifique par un jury exigeant. C'est le cas en France des programmes "blancs" de l'Agence nationale de la recherche (ANR). En laissant l'initiative aux chercheurs, cette approche permet de faire émerger des projets qu'une administration n'aurait pu identifier a priori.
Une seconde approche dite en "logique de mission" a été développée aux Etats-Unis d'abord dans le domaine militaire. Ainsi, Internet résulte en partie d'une recherche impulsée par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) dans un objectif précis : faire communiquer à distance des ordinateurs de constructeurs différents. Les Etats-Unis ont depuis créé des agences similaires dédiées à l'énergie ou à la santé. Cela permet de concentrer l'argent public sur des objectifs clairs, sans pour autant préjuger de la solution technologique. Et les travaux académiques tendent à montrer que cette approche en "logique de mission" a un réel effet d'entraînement sur l'activité de R&D des entreprises. En revanche, en France comme en Europe, les appels d'offres sont généralement lancés autour de grandes thématiques, sans objectif précis.
Il faudrait s'inspirer davantage de cette approche issue de la DARPA en lançant des appels d'offres ciblés et ambitieux. Le renforcement des budgets de la défense constitue à cet égard une réelle opportunité. Dans un travail récent intitulé "The Intellectual Spoils of War", l'économiste John Van Reenen et ses collègues montrent ainsi qu'accroître le budget de recherche militaire en France en le rehaussant à un niveau comparable (en proportion du PIB) à celui des Etats-Unis pourrait, à terme, relever de 10% les dépenses de R&D des entreprises françaises. Mais il ne faut pas se limiter au secteur de la défense, le faire au niveau de l'Europe pour des raisons de taille critique, en confiant le processus de décision à des scientifiques de haut niveau. Sans cela, l'Europe passera à côté des grandes ruptures technologiques.
Article paru dans Les Echos le 29 août 2025, n°24534
Illustration: Photo de National Cancer Institute sur Unsplash