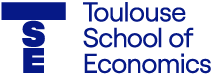Article paru dans Les Echos, n°24497, le 7 juillet 2025
Le principe de la compensation carbone est a priori gagnant-gagnant pour les Européens qui polluent et les pays en développement où naissent des projets écologiques. Mais le dispositif a des limites.
Après cette période de canicule, il est intéressant de se pencher sur l'un des mécanismes conçus pour lutter contre le réchauffement climatique: la compensation carbone. Il s'agit de permettre à un acteur économique de continuer à polluer en échange du paiement d'un service environnemental.
Le "mécanisme de développement propre" (MDP) mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto autorise ainsi des entreprises à financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des pays en développement...