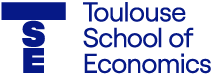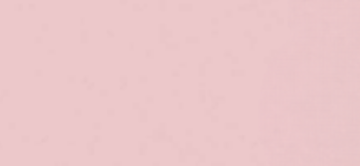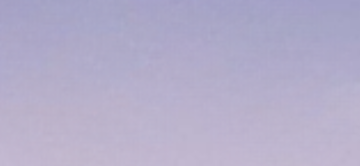La taxe Zucman ne rapporterait pas les 20 milliards d'euros promis. Il faut plutôt s'attaquer aux niches fiscales comme celle des transmissions. Mais cette approche est politiquement risquée, reconnaît Frédéric Cherbonnier.
Le débat autour de la taxe proposée par Gabriel Zucman a focalisé l'attention sur la fiscalité des gros patrimoines. Voyons comment le consensus des économistes sur cette question a évolué. On a d'abord considéré qu'il ne fallait pas taxer le capital. Selon un résultat célèbre obtenu en 1976 par les économistes Anthony Atkinson et Joseph Stiglitz, une fiscalité progressive sur le revenu du travail suffirait à limiter les inégalités - taxer le capital serait inutile et viendrait distordre les choix en matière d'épargne. Le consensus a profondément évolué depuis, parce que l'on s'est aperçu qu'en ne taxant que le revenu du travail, les ménages les plus riches échapperaient à l'impôt en se rémunérant sous une autre forme.
Des travaux récents le confirment avec des résultats étonnamment proches sur différents pays développés. Ils consistent à estimer le revenu économique des milliardaires sans se limiter au seul revenu déclaré et fiscalement imposable - comme les salaires et les dividendes perçus. Que ce soit aux Etats-Unis, en France ou dans les pays scandinaves, le taux d'imposition effectif des milliardaires serait proche de 25%. Les très hauts patrimoines parviennent ainsi à réduire leur taux d'imposition en logeant une partie de leurs bénéfices dans des sociétés.
Que penser de ce niveau d'imposition ? Ceux qui le trouvent trop faible le comparent à ce qu'il serait si l'ensemble du revenu des milliardaires passait en salaire, soit environ 59 % (ce taux ne prend pas en compte les cotisations sociales contributives pour la retraite et l'assurance chômage car elles donnent lieu à des prestations déjà prises en compte dans le revenu économique). En réalité, le taux d'imposition effectif moyen n'atteint pas un tel sommet. Les 1 % des ménages les plus aisés se voient imposer à un taux proche de 35 %, les 0,1 % les plus aisés à un taux proche de 45 %, puis le taux devient effectivement régressif et diminue jusqu'à atteindre 25% pour la centaine de familles les plus riches de France.
En pratique, la taxe Zucman ne cherche pas tant à relever le niveau d'imposition moyen des milliardaires qu'à instaurer une taxe minimale égale à 2% du patrimoine. Si l'on considère que le rendement moyen du patrimoine des milliardaires est de 8%, on retombe sur ce taux de 25%. Pourquoi alors une telle levée de boucliers? Deux raisons à cela : certains parviennent sans doute à réduire encore davantage leur imposition via des mécanismes d'optimisation ou d'évasion fiscale. D'autres payent peu d'impôts car leur richesse provient d'une start-up non cotée qui ne fait pas de bénéfices à ce stade, à l'instar du PDG de Mistral. Pour les premiers, on peut craindre qu'ils trouvent des moyens d'éviter cette nouvelle taxe, quitte à partir de France. Les journaux viennent de relever que des contribuables français déplaçaient en ce moment des fonds vers des places comme le Luxembourg et la Suisse. Pour les seconds, une telle taxe pourrait dissuader ce type d'entrepreneuriat innovant. Bref, la taxe Zucman risque de complètement rater son objectif budgétaire (20 milliards d'euros) tout en pénalisant l'économie française.
La bonne approche consisterait plutôt à cibler les dispositifs permettant de ne payer aucun impôt et ils sont nombreux! Notamment sur les transmissions : la majeure partie est imposée à un taux quasi nul grâce aux abattements dont bénéficient l'assurance-vie et les donations. In fine, le taux moyen d'imposition en ligne directe ne serait que de 3% selon France Stratégie (25% pour les très gros héritages). Idem pour les plus-values immobilières dont une bonne partie est totalement exonérée du fait de la durée de détention ou du statut de résidence principale. Mais cibler de telles niches fiscales est bien plus délicat sur le plan politique puisque cela concernerait beaucoup de ménages aisés. Il est plus facile de montrer du doigt une poignée de multimilliardaires.
Article paru dans Les Echos le 21 octobre 2025
Illustration: Photo de Towfiqu barbhuiya sur Unsplash