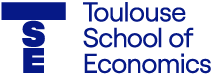Dès lors qu’il est admis que la transition énergétique consiste à remplacer les énergies fossiles par de l’électricité décarbonée, il reste à trouver le bon bouquet de production capable de fournir des volumes croissants de mégawattheures. Quelle place doit-on accorder à l’hydroélectricité dans ce bouquet énergétique ?
Les qualités électriques de l’eau
Puisque l’eau coule naturellement, elle permet de faire tourner des turbines à un coût quasiment nul. L’hydroélectricité a donc des propriétés semblables à celles de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques et les éoliennes : une fois payés les coûts fixes d’installation, la production est quasi-gratuite. Pour ce qui est de leur disponibilité, les trois technologies sont tributaires des énergies primaires correspondantes : eau, rayonnement solaire, vent. Néanmoins, la production hydroélectrique peut-être contrôlée si l’eau turbinée sort d’un réservoir, ce qui n’est pas le cas des énergie solaire et éolienne. Comme l’eau peut être relâchée et produire de l’électricité en quelques secondes, la flexibilité des centrales hydroélectriques est bien meilleure que celle des centrales thermiques et nucléaires. Elles contribuent donc plus efficacement au rééquilibrage du système électrique quand une unité de production fait subitement défaut. Lorsque la centrale est couplée à un système de pompage et à deux réservoirs (Station de Transfert d’Energie par Pompage ou STEP), l’eau permet également de stocker l’énergie. L’excès de production d’électricité solaire ou éolien peut être utilisé pour pomper de l’eau et la stocker dans des réservoirs d’altitude, pour ensuite la turbiner et alimenter le réseau électrique quand le besoin s’en fait sentir. Pour toutes ces raisons, l’hydroélectricité est, a priori, idéalement placée pour être la principale source d’énergie décarbonée. Néanmoins, son développement se heurte à deux obstacles : son impact sur l’environnement et son financement.
Hydroélectricité et environnement
Dans les pays disposant d’importantes ressources hydrauliques, la construction de barrages permettant de domestiquer l’énergie cinétique de l’eau s’impose comme une évidence. C’est le cas de la Norvège qui a récemment annoncé un partenariat avec le Department of Energy américain pour un programme de Recherche-Développement dans le domaine de l’hydroélectricité. Alors que l’électricité norvégienne provient déjà à 89% du turbinage de l’eau (et 9% de l’éolien), il est prévu d’augmenter encore cette production dans les années à venir. Pour ce faire, en février 2025 le Parlement norvégien a voté en faveur de la construction de centrales d’une puissance supérieure à 1MW sur certains des quelques 400 cours d’eau jusqu’alors protégés. Cette ouverture est assortie de conditions telles que des bénéfices sociétaux “significatifs” et des conséquences environnementales “acceptables”, un flou qui provoque la colère des mouvements écologistes prêts à une résistance acharnée contre chacun des projets envisagés. La protection de sites naturels et des populations de poissons est le premier obstacle au développement de l’hydroélectricité. L’époque est révolue où l’on pouvait construire des grands barrages sans se soucier des conséquences pour l’environnement et, si nécessaire, noyer des villages entiers. Mais c’est une option encore acceptable dans des pays en développement plus préoccupés de production d’énergie que de protection de la nature.
Le financement des ouvrages
La construction de barrages et de centrales hydroélectriques exige d’énormes capitaux à court-moyen terme, alors que les gains de la vente d’électricité vont s’étirer sur le long terme. Il en va de même des lignes à haute tension qu’il faut installer pour acheminer l’électricité produite vers les lieux de consommation. Les tours de table financiers sont donc difficiles à constituer, d’autant plus que l’activisme des défenseurs de la nature fait courir un risque sur les délais de construction et les sommes à engager. Une participation de l’Etat est souvent nécessaire, avec cette fois un risque d’incohérence des décisions au gré des échéances électorales. De plus, le financement ne s’arrête pas à la construction. En Europe, l’âge moyen de ces installations est de 45 ans, et de 50 ans en Amérique du Nord. Elles ont besoin d’être modernisées pour garantir une production fiable dans les prochaines décennies. A l’échelle mondiale, l’évaluation des investissements destinés à la modernisation des centrales les plus anciennes faite par l’Agence Internationale de l’Energie pour la période 2021- 2030 est de 127 milliards US$, soit un quart du total des investissements dans l’hydroélectricité.
Dérèglement climatique et apports en eau
Les atouts de l’hydroélectricité risquent de s’éroder avec le dérèglement du climat. D’abord parce que le réchauffement réduit les capacités de stockage naturel en altitude sous forme de neige et de glace. Avec des pluies concentrées sur des épisodes courts et l’eau ruisselant au lieu de s’infiltrer, il faut aussi s’attendre à des inondations répétées. Cette surabondance d’eau à certaines périodes va s’accompagner d’un stress hydrique à d’autres. Les pouvoirs publics vont probablement exiger des exploitants des barrages qu’ils privilégient la fonction d’écrêtement des crues et de soutien d’étiage, notamment pour l’irrigation, au détriment de la production d’électricité. Les entreprises qui exploitent des unités hydroélectriques demanderont une indemnisation pour les pertes engendrées par la fourniture de ce service. Les conflits d’usage de l’eau vont se multiplier.
Le contrôle des barrages, leur utilisation pour la production d’électricité, l’irrigation, la consommation domestique et industrielle, la régulation des cours d’eau, le refroidissement des centrales thermiques ou encore les loisirs, et la tarification de ces divers usages font déjà l’objet de débats intenses. On peut s’attendre à ce qu’ils deviennent de plus en plus clivants au cours des prochaines décennies. Il est souhaitable que la discussion s’engage par temps calme et non à l’occasion de crises ou de catastrophes. L’annonce faite le 28 août 2025 d’un accord de principe entre le Gouvernement français et la Commission européenne pour régler le contentieux du statut juridique des centrales hydroélectriques devrait permettre de relancer les investissements dans l’hydroélectricité, mais il reste à résoudre les nombreux autres problèmes soulevés par les usages de l’eau.