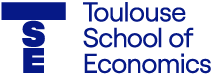Interview accordée par Jean Tirole à Bertille Bayart du Figaro Economie.
Le Figaro- Peut-on débattre sereinement de la régulation de la finance ? Le sujet est en effet très polémique, la finance étant dans beaucoup de discours politiques et dans l’opinion souvent considérée comme une activité nuisible …
Les excès de la finance créent des ressentiments légitimes chez les citoyens. Pour autant, la finance est indispensable à l'économie. Elle apporte des fonds aux entreprises (de la jeune pousse à l’entreprise du CAC 40), aux ménages et aux États pour couvrir leurs dépenses d’investissement et de fonctionnement. Elle fournit aux entreprises des solutions leur permettant de se couvrir contre des risques susceptibles de les déstabiliser (risques de change, de taux d’intérêt ou de défaillance d’une contrepartie …). Ce faisant, le système financier offre aux ménages des services allant des dépôts bancaires au système de paiements, en passant par l’assurance, les produits d’épargne et le financement partiel de leurs retraites.
Le débat doit porter sur une question clef : comment assurer ces fonctions essentielles tout en évitant que des entités peu scrupuleuses exproprient les investisseurs ou laissent une ardoise aux États ? La difficulté provient du fait que le sujet est technique, donc nécessairement délégué à des autorités de régulation publiques et spécialisées, alors que la crise de 2008 a mis en lumière une défaillance massive de l’État. Car si l’on peut regretter le manque d’éthique de certains acteurs du monde financier, ce n’est pas une incantation ou des stigmatisations qui éloigneront les crises financières; in fine une mauvaise régulation est en cause.
Le traitement de la crise en 2008-2009 – recapitalisations essentiellement publiques des banques, intervention des banques centrales, relance budgétaire - était-il le bon ?
La résolution d’une crise confronte les autorités à des choix peu enthousiasmants. On peut regretter les dépenses très importantes d’argent public, les taux d’intérêt très bas avec leurs conséquences néfastes, la récession… Mais il n’y avait pas beaucoup d’autres possibilités. Il aurait été beaucoup moins coûteux de prendre les précautions nécessaires quand tout allait encore bien.
Faut-il s’inquiéter du contexte actuel de taux extraordinairement bas, qui résulte de la politique monétaire ultra-accommodante qui a été mise en œuvre depuis la crise de 2008 ?
Les taux d’intérêt bas, si nécessaires soient-ils à la conservation de l’activité économique, ne sont pas sans coût. Ils impliquent une redistribution massive de richesse des épargnants vers les détenteurs de portefeuilles mobiliers et immobiliers, accroissant un peu plus l’inégalité de richesse. Ils facilitent l’émergence de bulles. Et ils deviennent une drogue pour les États, qui peuvent emprunter à coût bas. Enfin, ils perdent de leur efficacité quand il devient difficile d’entrer de baisser les taux d’intérêt car les taux nominaux sont négatifs, nécessitant alors un recours à des politiques non conventionnelles peu testées.
Vous avez travaillé sur les bulles, en particulier au début de votre carrière. Sont-elles toujours d’actualité ?
Les bulles (immobilières ou non) sont une constante dans l’histoire des crises bancaires. Ces actifs surévalués offrent tant qu’ils progressent des rendements supérieurs à la moyenne, mais perdent beaucoup de leur valeur quand la bulle éclate. Si les actifs sont détenus par des particuliers ou des institutions financières ne posant pas de risque systémique (ce fut le cas de la bulle Internet de 2001), l’éclatement de la bulle n’a que peu de conséquence macroéconomique, il redistribue juste les richesses. Par contre quand la bulle est détenue par des banques déjà endettées, l’impact macroéconomique de son éclatement est important et le contribuable est souvent mis à contribution.
Les bulles sont encouragées par des taux d’intérêt faibles. Et elles peuvent naitre à des endroits inattendus. Récemment, les marchés financiers se sont enthousiasmés pour de nombreuses cryptomonnaies. En termes économiques, Bitcoin est un exemple de bulle pure, un actif sans réalité économique sous-jacente- sa valeur tombera à zéro si la confiance en elle disparaît. Ce qui ne signifie pas qu'elle ne peut pas avoir de valeur financière: pensons à l'or. Il est impossible de prédire si Bitcoin deviendra le nouvel or ou bien ne vaudra plus rien dans un avenir proche (je pense par contre qu’il serait risqué d’autoriser les banques de détail à prendre des positions sur cet actif). Mais les actifs financiers, comme toutes nos institutions, doivent être au service du bien commun. Or, dans le cas des cryptomonnaies la valeur sociale est plutôt insaisissable (sauf dans des pays dysfonctionnels comme le Venezuela.
Comment rendre la supervision plus robuste ? Vous plaidez par exemple pour une « plus grande distance entre évaluateurs et évalués ». Mais ne peut-on pas redouter que, plus la distance est grande, plus le risque d’asymétrie de l’information – ou de différence de compétence – est grand ?
Vous avez raison. C’est le dilemme éternel. La régulation est une question d’insuffisance d’information des régulateurs face aux régulés (et des citoyens face aux régulateurs, les empêchant de vérifier s’ils font du bon travail). Le plus souvent, les candidats les plus compétents au poste de régulateur viennent du secteur régulé. Ceci dit, des règles gérant les conflits d’intérêt (la célèbre porte tournante, « revolving door ») peuvent limiter la connivence. L’utilisation de contre-pouvoirs (des commissions parlementaires, des opinions d’universitaires, une presse économique compétente …) peuvent aussi œuvrer dans ce sens.
Je prêche surtout pour l’indépendance des autorités de régulation. L’action politique est fortement soumise aux lobbies ou simplement au désir de plaire (rappelons-nous ici de l’encouragement par les politiques américains et espagnols du boom immobilier et des prêts subprime). De plus, une bonne régulation est nécessairement technique, avec des arbitrages complexes à réaliser. Pour autant, l’indépendance des autorités de régulation n’est pas une panacée; la compétence de ses membres doit être garantie par une sélection portant essentiellement sur cette qualité, et leur intégrité doit faire l’objet d’attention.
Les réformes post 2008 ont-elles réellement amélioré la sécurité du système ? Est-il légitime de dire que ces textes favorisent les acteurs américains par rapport aux acteurs européens ?
Globalement, Bâle III représente un progrès. Les recommandations de nombreux économistes ont été suivies: par exemple, l’accroissement des exigences en fonds propres, rendues aussi contracycliques (les banques devant garder plus de fonds propres dans les périodes fastes comme coussin pour les périodes de vaches maigres créées par le boom précédent du crédit ou par d’autres facteurs); l’introduction d’un ratio minimal de liquidité; l’utilisation plus répandue de plateformes centralisées et transparentes plutôt que de marchés de gré à gré (OTC) nécessairement opaques; l’amélioration des infrastructures réglementaires avec un rôle accru de la Fed aux États-Unis et la création d’une supervision centralisée à la BCE en Europe. Et il ne me semble pas que Bâle III favorise particulièrement les institutions américaines (de toute façon, ceci est sans doute un débat secondaire à un moment où les États-Unis s’engagent dans un processus de dérégulation anti Bâle III et anti Dodd-Frank).
Pour autant de nombreux dangers subsistent. Certains sont inhérents aux difficultés de l’exercice. Les exigences en fonds propres et en liquidités sont difficiles à calibrer dans un monde bancaire en constante évolution. Par exemple le nouveau ratio de liquidité est bien intentionné, mais il n’a jamais été testé. Les paniques bancaires sont parfois auto-réalisatrices. Il n’y a jamais de risque zéro, et des erreurs peuvent être commises, créant des brèches dans lesquelles certains acteurs s’empresseront de s’engouffrer.
Mais le risque principal n’est pas là: il est en nous-mêmes. De nombreux dangers sont liés la tentation de la déréglementation, le laxisme face aux bulles, la détention excessive par les banques de bons du Trésor nationaux en Europe, le surendettement privé ou étatique, l’insuffisance de la coopération internationale en termes de supervision (les États cherchant trop à favoriser leurs propres banques) et de résolution des banques en difficulté …
Enfin, de bonnes régulations peuvent être inopérantes si les décrets de mise en œuvre nationaux créent des échappatoires ou si les superviseurs bancaires les appliquent de manière laxiste. Les bonnes intentions peuvent être perdues lors de leur interprétation, ce qu’il est difficile de vérifier sans une étude approfondie et requérant une certaine expertise. Prenons le cas des régulations (Dodd-Frank aux Etats-Unis, CRR en Europe) imposant aux banques de garder une part du risque (« skin in the game ») lors d’une titrisation ; ces régulations ont pour but d’inciter les banques à octroyer des prêts moins risqués et à suivre ces prêts. Les mises en œuvre ultérieures de l’idée originale de responsabiliser ainsi les banques ont prévu des échappatoires à la fois aux États-Unis et en Europe. De plus, le diable est dans le détail, ce qui rend la tâche de surveillance complexe pour un observateur extérieur: la banque doit garder 5% du risque, mais de quel risque ? Des tranches junior très risquées, ou des tranches peu risquées ? De toutes ou en moyenne ? Calculées en valeur de marché ou en valeur nominale ? Les banques ont-elles un choix dans un menu d’options ? Etc… Enfin, la surveillance au jour le jour peut être déficiente. Rappelons-nous les 100 milliards de dollars de dividendes et rachats d’action en 2007-2008, alors que de nombreuses banques américaines étaient en difficulté.
La taille des banques et de leur bilan est-elle un sujet ? Faut-il la brider ?
Oui et non. Il est vrai que la faillite d’une grosse banque a plus de chances de créer des effets systémiques: elle peut générer d’une part des problèmes de liquidité pour les contreparties qui seront remboursées de façon incertaine et tardive, d’autre part une chute des prix des actifs lors de ventes à prix bradés (créant des difficultés supplémentaires pour le renflouement de la banque en faillite et également pour les autres institutions qui voudraient vendre des actifs similaires pour obtenir de la liquidité). C’est pour cela que les exigences en fonds propres ont été augmentées pour les institutions financières « systémiquement importantes ».
Mais il faut bien voir que les problèmes financiers peuvent également avoir leur origine dans les petites banques : regardez les Cajas en Espagne ou les Sparkassen et les Landesbanken en Allemagne. Ensuite, l’aspect systémique est toujours difficile à évaluer. LTCM (Long-Term Capital Management) en 1998 n’était pas vraiment gros, mais il fut jugé systémique et nécessita une intervention vigoureuse. AIG aurait-il été jugé systémique avant 2008? Je ne sais pas. En fait le potentiel de contagion financière dépend du bilan de l'institution en difficulté, de la corrélation de ses expositions au risque, de la nature de ses contreparties, etc. Donc oui il faut être vigilant avec les grosses banques, mais la qualité de la supervision me semble plus importante.
La séparation des activités de marché et des activités de détail est-elle une bonne idée ?
Cette séparation a une logique, mais il faut aussi comprendre que d’une part elle n’est pas facile à mettre en œuvre et d’autre part elle n’est pas la panacée. De nombreuses banques ayant eu recours au soutien public depuis 2008 étaient soit des banques d’investissement pures (AIG, les grandes banques d’investissement américaines …), soit des banques de détail (les Cajas, les banques Allemandes, Northern Rock...). Une banque peut prendre beaucoup de risque en se concentrant sur des activités « plan-plan » : les prêts immobiliers ou aux PME, l’offre de couverture de taux de change, l’offre de produits d’épargne à taux ou principal garantis… Ces activités de fait exposent la banque à des risques macroéconomiques (fluctuations des taux d’intérêt ou de change, fluctuations des prix de l’immobilier, des actions ou des obligations…). C’est pour cela que la mise en œuvre de la séparation structurelle, telle que celle de John Vickers au Royaume-Uni, peut prévoir que la banque de détail puisse couvrir ces risques; ce qui est légitime, mais ouvre une autre boite de Pandore: la banque va-t-elle utiliser cette possibilité d’accéder aux marchés de couverture pour s’assurer ou au contraire pour accroitre son risque?
L’important au fond est de s’assurer qu’au-delà d’une capitalisation correcte de leurs activités régulées, les banques de détail ne soient mises en danger par le « shadow banking », le secteur non-régulé. Tout d’abord, il faut que la banque de détail ait suffisamment de fonds propres si elle est obligée de venir au secours d’activités en dehors et que ces obligations soient clairement spécifiées. En 2007-2008, les exigences en fonds propres pour les lignes de liquidités octroyées par les banques de détail aux « conduits » hors-bilan qu’elles avaient créés lors des opérations de titrisation étaient ridiculement faibles; cette échappatoire fut depuis supprimée, mais bien sûr d’autres façons de réduire les fonds propres règlementaires par des interactions avec le shadow banking peuvent resurgir. Ensuite, il faut faire attention à ce que la banque de détail ne soit pas trop exposée au risque de contrepartie avec des acteurs non-régulés. C’est ce que j’appelle le « syndrome AIG » : le gouvernement américain fut amené à sauver cet acteur du shadow banking, parce que les contreparties d’AIG étant souvent des institutions régulées.
La régulation en zone euro a progressé. Mais la lenteur à traiter les problèmes des banques italiennes par exemple ne permet-elle pas de douter de son efficacité ?
La centralisation de la supervision à la BCE est un progrès important, même si en pratique chaque pays résiste et veut un traitement privilégié de ses banques (on le voit en ce moment avec l’Italie). Cette centralisation est importante à la fois pour concentrer l’expertise régulatoire et surtout protéger les régulateurs de la pression politique et des lobbies. Et même s’il faut donner du temps à l’institution pour faire ses preuves, et aux politiques pour respecter son indépendance, le fait que les banques européennes sont désormais soumises à des règles du jeu communes permet d’envisager une assurance-dépôt commune.
Mais abordons l’éléphant dans la boutique de porcelaine: le traitement des dettes souveraines. Aujourd’hui l’on fait toujours comme si elles étaient complètement sûres, ce qui n’est pas le cas (ou alors implique une implication potentielle du contribuable européen pour les rendre sans risque). Cette fiction d’absence de risque est une échappatoire permettant d’investir sans fonds propres. Pire : les banques sont non seulement incitées à détenir des obligations d’État, mais elles ont aussi une incitation forte à l’absence de diversification en la matière, comme de nombreux économistes l’ont montré. De facto, les marchés se sont re-segmentés après 2010. Aujourd’hui les banques italiennes détiennent essentiellement des bons du Trésor de leur pays (c’est aussi le cas ailleurs en Europe). Mais cette politique accroit le risque : en cas de problème souverain, les banques perdent de l’argent et peuvent nécessiter une recapitalisation publique mettant à contribution un État déjà exsangue (et inversement des problèmes bancaires peuvent créer, comme on l’a vu en Espagne et en Irlande, des problèmes de dette souveraine qui peuvent aggraver les problèmes bancaires). Les régulateurs européens en la matière ont été un peu laxistes et n’ont pas écouté les recommandations des économistes; et il n’est pas facile d’accroitre les exigences en fonds propres lorsqu’une crise est déjà en route…
Approche-t-on déjà, surtout aux Etats-Unis, du moment où, par un retour de balancier, on va commencer à déréguler ?
Les crises, qu’elles soient bancaires ou de dette souveraine, ont pour origine un laxisme dans les périodes plus fastes. Quand les choses semblent aller bien, l’on ne veut pas casser la croissance ou s’opposer aux lobbies. C’est une constante.
Oui, les États-Unis, comme d’autres, sont en train d’oublier les leçons de la crise et les leçons de l’économie tout court. Prenons par exemple les prêts immobiliers risqués, les fameux subprimes, que les gouvernements américains ou espagnols ont tellement encouragé dans le passé (avec les conséquences que nous connaissons). La réglementation plus stricte qui suivit la crise des subprimes rendit l’émission de tels prêts plus coûteux pour les banques de détail- les banques régulées-, par exemple en relevant les exigences en fonds propres pour de tels prêts ou en exigeant que les banques conservent une partie minimale de ces prêts quand elles les titrisent (c’est-à-dire, revendent à d’autres acteurs financiers une partie des revenus associés au remboursement futur des prêts immobiliers en cours). C’était logique. Sauf que… L’émission de prêts subprime de façon prédictible migra aux États-Unis vers le secteur non-régulé des shadow banks, qui aujourd’hui émet 75% de ces prêts et ne garde que 5% du risque afférant quand elles les titrisant (contre 25% pour des banques de détail). Cela ne serait pas grave si aucun argent public n’était en jeu. Cependant, l’acheteur n’est autre (à 85%) que … l’État américain. En d’autres termes, le contribuable américain subventionne les banques non-régulées et devra payer une ardoise importante en cas de nouvelle crise immobilière.
Donald Trump cherche aussi à s’affranchir de la régulation bancaire…
Tout à fait, même s’il n’a pas pu faire pour l’instant tout ce qu’il voulait. Il remet en cause à la fois les régulations internationales (Bâle III) et les lois américaines. Il s’oppose aux mesures principales de la loi Dodd-Frank (2010), telles que la protection des investisseurs, le contrôle des activités pour compte propre, et l’utilisation de stress tests réguliers par la Fed pour vérifier la solidité du système bancaire.
La réforme de la régulation des fonds de placement collectifs est aussi remise en cause. Le danger ici est que les petits épargnants ne traitent ces fonds comme des dépôts ou plus généralement des produits d’épargne sûrs, et que l’État ne soit obligé d’engager des fonds publics pour renflouer ces fonds de placement collectifs comme il le fit en 2008.
Trump critique aussi la Fed sur la hausse des taux d’intérêt…
Comme Erdogan en Turquie et plus généralement les populistes dans de nombreux pays- dont le nôtre-, il est mal à l’aise avec l’indépendance de la Banque centrale, pourtant un des piliers de nos systèmes économiques modernes. Et comme tous les populistes, il privilégie le court terme et s’oppose à la remontée des taux d’intérêt, qui ont été anormalement bas depuis 10 ans dans le monde et aujourd’hui peuvent prudemment être remontés dans une économie américaine peu affectée par le chômage.
Interview accordée au Figaro Economie, publiée le 31 aout 2018