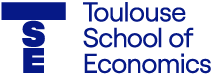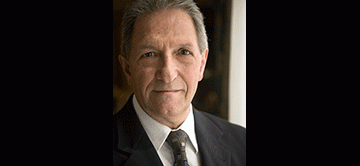L’économiste César Hidalgo explique, dans une tribune au "Monde", pourquoi le programme "Choose Europe", mis en place par l’Union européenne pour attirer des chercheurs présents sur le sol américain, va, selon lui, échouer et propose des pistes pour l’améliorer.
Une occasion unique se présente à l’Europe : attirer les universitaires installés aux Etats-Unis. Pourtant, tout laisse à penser qu’elle risque de gâcher cette chance. Aujourd’hui, plus de 100 000 Européens titulaires d’un doctorat travaillent aux Etats-Unis. Conscients de ce phénomène, les gouvernements et les universités européennes multiplient les annonces de programmes visant à attirer ces chercheurs expatriés. Cependant, pour ceux qui connaissent bien le système universitaire américain, ces efforts apparaissent bien trop modestes.
Lundi 5 mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un programme doté de 500 millions d’euros sur deux ans destiné à attirer des chercheurs internationaux. Mettons ce chiffre en perspective: aux Etats-Unis, de nombreuses universités fonctionnent avec un modèle de dotation, sorte de grand compte d’épargne, dont elles dépensent environ 4 % par an tout en faisant fructifier le capital restant.
Le programme "Choose Europe" équivaut ainsi au rendement annuel d’une dotation d’environ 250 millions d’euros, loin derrière les dotations annuelles d’universités comme Harvard, Princeton ou Yale. Cette somme correspond plutôt au rendement de l’université d’Etat de l’Ohio.
L’investissement européen est non seulement modeste, mais l’écart actuel de rémunération entre les continents est énorme. Un professeur titulaire à l’université Complutense de Madrid gagne environ 35 000 euros par an. A l’université du Michigan, le salaire moyen des professeurs atteint 207 000 dollars [186 000 euros] annuels. Ainsi, en quatre ans, un professeur du Michigan gagne plus que ce qu’un professeur titulaire espagnol touche en vingt ans. Un fossé considérable.
Combattre le feu par le feu
Certes, certains pays européens, comme le Danemark, rémunèrent mieux leurs universitaires que la France, l’Italie ou l’Espagne. Mais, même là, la balance penche généralement en faveur des Etats-Unis. Pour convaincre les chercheurs européens expatriés de quitter leur laboratoire américain et de relocaliser leur famille en Europe, il faudra davantage que ce qui est actuellement proposé. Si les budgets reflètent les priorités, l’Europe ne joint pas véritablement le geste à la parole.
Cependant, l’objectif de cette tribune n’est pas de simplement critiquer la timidité de la politique européenne d’innovation, mais plutôt d’encourager l’Europe à être audacieuse face à cette opportunité unique. L’Europe est non seulement un lieu de vie exceptionnel, mais également le berceau d’idées fondamentales. Alors, comment refaire de l’Europe une puissance mondiale de la recherche ?
Une solution serait de combattre le feu par le feu, en créant un fonds européen de recherche. Ce fonds continental permettrait à l’Europe de rivaliser directement avec les Etats-Unis dans l’attraction des talents. Par exemple, en imaginant une dotation égale à un huitième des 800 milliards d’euros prévus pour le réarmement européen, cela représenterait 100 milliards d’euros investis par une équipe professionnelle. Ce montant équivaudrait à peu près à la somme des dotations de Harvard, Yale et Stanford, une échelle raisonnable pour une initiative à l’échelle continentale. Avec un rendement annuel de 4 %, cela générerait 4 milliards d’euros supplémentaires par an pour financer la recherche, de manière pérenne.
Ces 4 milliards représenteraient une augmentation de 30 % à 40 % du programme européen « Horizon », doté actuellement d’environ 12 milliards d’euros par an. Cet argent pourrait financer, par exemple, 4 000 chaires d’excellence dotées chacune de 1 million d’euros par an, de façon permanente. Ce montant doublerait le soutien annuel offert par la prestigieuse bourse ERC, actuellement d’environ 2,5 millions d’euros sur cinq ans.
Implication des chercheurs dans l’entrepreneuriat
L’Europe pourrait aussi explicitement favoriser les professeurs-entrepreneurs. Contrairement aux Etats-Unis ou à la Chine, où la figure du professeur-entrepreneur est courante et valorisée, le transfert technologique en Europe repose principalement sur des collaborations entre entreprises et universités, générant beaucoup de rencontres, mais peu de start-up menées par des professeurs. Aux Etats-Unis, Bob Langer, professeur au MIT, a, par exemple, contribué à la création de plus de trente entreprises. L’implication directe des chercheurs dans l’entrepreneuriat garantit une meilleure diffusion des idées innovantes vers le marché. Loin d’être un gaspillage d’argent public, cela constitue un levier efficace pour traduire la recherche académique en progrès économique et technologique concret.
Enfin, l’Europe doit simplifier son administration, souvent caricaturalement complexe. Les universitaires espagnols sont célèbres pour devoir demander aux organisateurs de congrès des diplômes fictifs afin de justifier leurs frais de déplacement (le fameux "papelito español"). En France, je me souviens avoir commandé un ordinateur portable pour un postdoctorant arrivé dix-huit mois plus tard, soit huit mois après son départ. L’Europe gagnerait beaucoup à simplifier ou supprimer certaines procédures administratives.
Le monde académique européen est face à une opportunité exceptionnelle : attirer des chercheurs américains aujourd’hui plus enclins que jamais à quitter les Etats-Unis. Mais pour devenir une alternative crédible, l’Europe doit s’organiser efficacement. Je doute que cela arrive. J’espère me tromper.
Article paru dans Le Monde le 16 mai 2025
Illustration: European Parliament from EU, CC BY 2.0