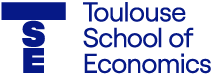Elena PANOVA soutiendra ses travaux pour l'HDR en sciences économiques le jeudi 20 Novembre à 09h30, en ligne (zoom)
"Five Applications of Game Theory to Problems Involving Differentiated Agents"
Pour assister à la présentation, merci de contacter le secrétariat Christelle Fotso Tatchum.
Le jury est composé de :
- Thomas Mariotti : Directeur de recherche CNRS/TSE-R
- Andrew Rhodes : Professeur d'économie, GE-TSE, Université Toulouse Capitole
- Enriquetta Aragones : Professeure d'économie, Institut d'Anàlisi Econòmica (IAE) Rapporteure
- Annick Laruelle : Professeure d'économie, Universidad del Pais Vasco Rapporteure
- Daniel F Garrett : Professeur d'économie, University of Essex Examinateur
Résumé
Cette candidature à l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) s’appuie sur cinq articles de recherche qui mobilisent la théorie des jeux pour analyser des problématiques appliquées dans différents domaines, allant de l’économie politique (prolongeant la ligne de recherche amorcée au cours de ma thèse de doctorat) à la formation de réseaux (introduite plus tard dans mon agenda de recherche), ainsi qu’à la régulation des opérateurs de réseaux, incluant le partage des coûts et la régulation incitative (thématique issue de collaborations avec des partenaires privés de la Toulouse School of Economics entre 2019 et 2023). Le fil conducteur de ces travaux réside dans leur nature appliquée et, d’un point de vue technique, dans la présence d’hétérogénéité parmi les agents participant aux jeux étudiés. Ces travaux sont présentés ci-dessous dans un ordre chronologique inverse.
A. Régulation des opérateurs de réseaux
1.1. Régulation des investissements lorsque les coûts et les besoins sont privés
Une question cruciale pour la régulation des services publics concerne la mise en place d’incitations aux grands investissements. L’une des principales difficultés pour le régulateur tient à l’incertitude quant à l’utilité finale de ces investissements. Un exemple emblématique de ce type de situation est la régulation des investissements réalisés par un réseau de transport d’électricité, motivés par la transition anticipée vers les énergies propres. Dans notre article «Regulating investments when both costs and need are private», coécrit avec Daniel F. Garret (révisé et resoumis pour publication dans Games and Economic Behavior), nous décrivons la régulation optimale d’investissements d’infrastructure à grande échelle réalisés dans des contextes où leur utilité ou importance finale est difficile à prévoir. L’agent qui réalise l’investissement détient une information supérieure sur deux dimensions : le coût de l’investissement et la probabilité que celui-ci soit utile ou bénéfique au principal. Par souci de soutenabilité financière, la régulation vise à garantir que les profits de l’entreprise restent non négatifs à chaque période. Nous caractérisons le mécanisme de régulation optimal et montrons qu’il dépend fortement du l’ampleur de l’asymétrie d’information dont dispose l’entreprise sur l’utilité potentielle de l’investissement. Tant que cette asymétrie demeure relativement faible, la régulation optimale présente une structure similaire à celle d’un cadre où seule l’incertitude sur le coût est présente. En revanche, lorsque l’asymétrie d’information sur l’utilité devient importante, le mécanisme optimal peut comporter des distorsions à la hausse de l’investissement et des rentes pour tous les types d’agents. Si nos résultats peuvent sembler pessimistes quant à la nature de la régulation optimale dans les projets d’investissement marqués par une forte incertitude sur leur utilité finale, nous les voyons comme un repère théorique à partir duquel la politique de régulation peut chercher à s’améliorer.
1.2. Partage du coût d’un réseau entre utilisateurs hétérogènes
Le problème du partage de coûts communs est pertinent dans de nombreux contextes économiques. L’approche axiomatique des problèmes de partage de coûts propose des règles caractérisées par un ensemble de propriétés souhaitables, spécifiques au problème. Dans mon article « Sharing cost of network among users with differentiated willingness to pay », publié dans Games and Economic Behavior (2023), j’adopte une approche axiomatique afin de proposer une règle de partage du coût d’un réseau de distribution fixe non congestionné entre des utilisateurs ayant une volonté de payer différenciée. Ce problème se pose, par exemple, dans l’industrie de la distribution de gaz, où le coût du réseau est censé être couvert par les revenus du marché régulé. Certains consommateurs, tels que les industriels ou les grands immeubles chauffés au gaz, présentent une forte disposition à payer, tandis que d’autres, comme les ménages, ont une disposition plus modeste. Comment ces différences de localisation et de disposition à payer doivent-elles se refléter dans leurs factures ? Pour répondre à cette question, j’analyse un modèle dans lequel les agents, différenciés par leur localisation et leur disposition à payer pour le bien, sont connectés à la source par un réseau fixe non congestionné en forme d’arbre. Je montre que le problème de partage de valeur associé est convexe, ce qui motive mon premier axiome exigeant que la solution appartienne au cœur (core). Cette exigence avec deux autres axiomes : « split- and merge-proofness » et un axiome normatif propre à mon cadre, appelé « absence de discrimination spatiale » caractérisent une solution simple à calculer, fondée sur une idée de proportionnalité. Cette règle pourrait servir de base à l’élaboration de tarifs régulés dans la distribution du gaz.
B. Clustering dans les réseaux sociaux avec des participants aux aprioris divergentes
Les réseaux sociaux contribuent à la diffusion d’informations et de comportements. De plus en plus de travaux montrent que la vitesse et l’étendue de cette diffusion dépendent des caractéristiques du réseau. L’une des propriétés clés des réseaux sociaux est le clustering : la tendance des contacts d’un individu à être également connectés entre eux, formant des groupes fortement liés. Si des études antérieures ont montré que cet aspect des réseaux permet d’expliquer divers phénomènes, les raisons de sa prévalence et de son impact restent largement inexplorées. Dans notre article conjoint avec Thibault Laurent, intitulé « Clustering in Communication Networks with Different Minded Participants » publié dans Social Choice and Welfare (2025), nous examinons comment la structure des réseaux de communication influence l’apprentissage et le bien-être social lorsque les participants ont des aprioris différentes et font face à une incertitude concernant l’état externe. Nous considérons un jeu dans lequel les joueurs disposent des aprioris subjectives imparfaitement corrélées sur un état de nature pertinent. Ils établissent des liens dans le réseau, reçoivent des signaux privés sur l’état et annoncent leurs attentes postérieures à leurs voisins du réseau sur deux tours successifs. La désutilité d’un joueur est mesurée par la variance postérieure subjective (son incertitude restante). Pour garantir la tractabilité, nous introduisons deux hypothèses simplificatrices : une connaissance imparfaite du réseau lointain et une corrélation arbitrairement faible des croyances initiales (priors). Nous fournissons une expression analytique reliant le gain d’un joueur à l’architecture du réseau, caractérisons le réseau efficient en sens de Rawls et montrons qu’il constitue un équilibre. Nous démontrons numériquement que nos résultats peuvent rester valables lorsque deux hypothèses simplificatrices sont assouplies, c’est-à-dire lorsque les joueurs connaissent leur réseau local et distant et que la corrélation de leurs croyances initiales prend des valeurs plus élevées (mais pas excessives). En outre, le critère d’efficience Rawlsien peut être remplacé par le critère utilitariste plus commun. Nos résultats sont susceptibles d’être pertinents dans des contextes tels que l’apprentissage sur les mérites relatifs de différentes politiques publiques ou l’adoption d’innovations (technologies, médicaments, produits, etc.). Dans ces scénarios, des différences dans les croyances initiales peuvent créer des barrières à l’apprentissage, et le clustering contribue à les atténuer. Cet effet offre une explication possible à la prévalence du clustering dans les réseaux sociaux réels.
C. Campagnes politiques et comportement électoral
Au cours de mes études doctorales et des années suivantes, mes recherches se sont concentrées sur le domaine de l’économie politique. Deux articles présentés ci-dessous illustrent cette ligne de recherche. Le premier article vise à mieux comprendre le comportement électoral et les résultats des élections. Un argument central en faveur du vote repose sur sa capacité à choisir des politiques publiques conformes aux intérêts communs, sur la base de l’information agrégée provenant des différents électeurs. La propriété d’agrégation d’informations du vote est établie dans des contextes où chaque électeur se comporte de manière à améliorer le résultat, sous condition d’être pivot. Ces objectifs sont qualifiés d’instrumentaux. Un électeur ayant des objectifs instrumentaux vote s’il possède une information privée (et non publique) pertinente, et s’abstient sinon, car il est alors plus susceptible de nuire, plutôt que d’améliorer, la décision de vote des électeurs mieux informés. Bien que certaines expériences montrent que l’information des électeurs augmente la participation, voter avec une information imparfaite est assez courant. De plus, les choix de vote sont sensibles à l’information publique, telle que les campagnes électorales et les résultats des sondages d’opinion. Ces observations suggèrent que la motivation des électeurs n’est pas purement instrumentale. Plusieurs études proposent que les électeurs tirent une utilité du simple fait de voter, qualifiée de motivation expressive, formalisée de différentes manières (soit comme un bénéfice de voter d’une certaine façon, soit comme un gain dépendant des choix de vote des autres électeurs). Ces études ont été critiquées pour l’absence de prédictions robustes concernant l’effet de la motivation expressive sur le comportement électoral et les résultats. Mon article intitulé « A Passion for Voting » publié dans Games and Economic Behavior (2015) propose un cadre pour analyser cet effet. Mon approche de modélisation est motivée par l’effet observé du vote habituel, qui n’avait pas été pris en compte dans les théories de vote instrumentales ou expressives : la participation à une élection augmente la propension à voter lors de l’élection suivante. Je considère un jeu de vote avec des élections successives. Une population continue d’électeurs choisit des politiques publiques selon la règle de la majorité simple, avec un objectif commun d’aligner leur choix de politique sur un état de nature caché. Une minorité d’électeurs reçoit des signaux informatifs sur l’état ; les autres restent ignorants, recevant des signaux non corrélés à l’état. Chaque électeur supporte un coût (temporel) pour voter et reçoit un bénéfice égal à sa confiance dans son choix de vote. Il peut s’abstenir s’il le souhaite. Il dispose d’une mémoire sélective : bien qu’il connaisse initialement la qualité de son signal privé, à l’élection suivante il se souvient uniquement de son comportement de vote passé et du résultat majoritaire. Si le jeu était statique ou si la mémoire de l’électeur était parfaite, les électeurs ignorants s’abstiendraient, laissant les électeurs informés choisir le résultat correspondant à l’état. Cependant, dans le jeu de vote répété, un électeur ignorant est incité à dévier et à voter : s’il se retrouve par hasard dans le groupe des gagnants, il gagne en confiance pour son vote futur, lui permettant de recevoir un bénéfice expressif lié au vote. Je caractérise l’unique équilibre Bayésien parfait symétrique et montre qu’il rend compte de comportements pertinents : vote avec information imparfaite, influence de l’information publique sur les choix de vote (effets de bande et de candidat outsider) et vote habituel. Je montre également que lorsque le signal public en faveur d’une politique ou d’une alternative électorale est suffisamment fort, le vote expressif peut nuire aux résultats électoraux, ce qui constitue une explication possible de la persistance observée de certaines politiques publiques et des taux élevés de réélection. Le deuxième article, intitulé “Partially Revealing Campaign Promises” et publié dans le Journal of Public Economic Theory (2017), s’interroge sur les raisons pour lesquelles les politiciens en fonction ont tendance à tenir leurs promesses électorales, alors qu’aucune contrainte légale ne les y oblige. L’article modélise les promesses de campagne comme un cheap talk pur. Les promesses électorales d’un candidat constituent un signal partiellement révélateur de son type de préférence politique. Le choix de politique publique du titulaire constitue un autre signal de son type. Contrairement aux promesses de campagne, le choix de politique est un signal coûteux. Le titulaire a tendance à respecter ses promesses électorales afin de préserver l’ambiguïté sur son type, ce qui est nécessaire pour rassembler une majorité gagnante en vue de sa réélection. Il respecte ses promesses indépendamment des informations concernant l’efficacité des différentes politiques publiques qu’il reçoit une fois en fonction. Par conséquent, les promesses électorales génèrent des inefficacités dans la politique publique.