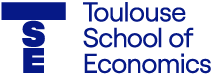Interview de Jean Tirole accordée à Corinne Lhaik, l'Express
© L'EXPRESS
Comment l’idée de ce livre vous est-elle venue ?
Le 13 octobre 2014, je reçois le Prix Nobel, et c’est le début d’une aventure qui propulse l’universitaire que je suis hors de ce bureau. Tout à coup, je deviens un homme public. C’est un peu bizarre… On me demande de tout commenter alors que, comme tout un chacun, j’ai mes spécialités et mes limites. On m’a posé énormément de questions sur le marché du travail. Je l’ai étudié, mais ce n’était pas le sujet du Prix Nobel. On m’a questionné, de la fiscalité à la politique, sujets dont je ne suis pas expert. Les médias m’ont sollicité, j’ai fait des rencontres, dans les lycées, dans les universités, dans mes anciennes écoles. Dans la rue, des gens que je ne connaissais pas me disaient : « Vous n’écrivez que des choses techniques. » Je comprends ce besoin de l’opinion. Depuis longtemps, je pense qu’on a les politiques économiques que l’on mérite, que sans culture économique du grand public, les dés sont pipés contre les bons choix. Mais notre rôle d’économiste, c’est de faire de la recherche et de l’enseignement. D’un point de vue purement professionnel, mieux vaut écrire un article dans une revue scientifique que de divulguer son savoir. Et pour être honnête, jusqu’à présent, c’est comme cela que j’ai vécu. C’est donc la première fois que j’écris pour le grand public.
Assumez-vous avoir écrit un livre de vulgarisation ?
Je préfère parler de pédagogie. J’ai écrit ce livre pour le plus grand nombre. Au premier abord, la science économique n’est pas évidente, mais fondamentalement, elle n’est pas si compliquée. Elle est intéressante, amusante et presque ludique par moments. C’est comme le base-ball ou le rugby, passionnant si l’on en comprend le fonctionnement. L’opéra aussi, c’est exigeant au début, si l’on n’en a jamais écouté (moi, je l’ai découvert sur le tard). La difficulté naît du fait qu’en économie, beaucoup de choses sont contre-intuitives. Je cherche donc à donner des explications en des termes relativement simples, sans sacrifier la rigueur.
Tout le monde peut comprendre ?
Il reviendra aux lecteurs d’en juger, mais je l’espère ! J’ai essayé d’expliquer des mécanismes complexes avec des termes compréhensibles.
Que vous a appris l’écriture de ce livre ?
A faire passer des messages. Franchement, il est beaucoup plus facile pour un chercheur de faire un cours de doctorat que de parler au grand public. Ce dernier souffre de l’absence d’éducation économique ; il peut lui manquer un maillon dans la chaîne de la compréhension, qu’il faut repérer. Je serai heureux si le lecteur apprend quelque chose. Même s’il est en désaccord sur la plupart des sujets. Si le livre déclenche la réflexion, incite à voir les choses différemment, j’aurai gagné mon pari.
Vous écrivez que l’économie est au service du bien commun. Qu’est-ce que le bien commun ?
C’est l’intérêt général pour la société. Ce n’est pas à l’économiste de le définir. Il s’agit d’un choix politique, variable d’une société à l’autre. L’économie est une des clefs pour atteindre l’intérêt général en faisant que l’intérêt personnel rejoigne l’intérêt collectif ; elle permet d’augmenter la taille du gâteau, et, si l’on veut redistribuer le gâteau choix politique que la redistribution soit efficace, que l’argent public soit bien ciblé.
Pourtant, vous reconnaissez que l’on n’a pas toujours envie d’entendre les messages des économistes.
Ils sont parfois perçus comme anxiogènes. De même que nous voulons nous croire à l’abri du cancer ou des accidents de la route, nous ne voulons pas penser que l’explosion de la dette publique puisse remettre en question la pérennité de notre modèle social ou qu’il faudra faire un effort pour résoudre le réchauffement climatique.
D’autre part, et comme je l’explique dans le livre, en matière de politique économique, l’enfer est pavé de bonnes intentions : l’effet direct d’une politique peut être louable, mais ses effets indirects peuvent rendre la politique néfaste. En économie, contrairement à la médecine, les victimes des effets secondaires sont souvent des personnes différentes de celles auxquelles le traitement s'applique. L’économiste s'oblige à penser aussi aux victimes invisibles, se faisant ainsi parfois accuser d’être insensible aux souffrances des victimes visibles.
Un exemple concret ?
Le chômage. Beaucoup de gens disent : « Si on facilite le licenciement, comment va-t-on améliorer l’emploi ? ». Effectivement, si on le facilite, les entreprises vont commencer par licencier des salariés en surcroît. L’économie nous apprend à aller au-delà ce raisonnement, en regardant les effets indirects.
Aujourd’hui, 90 % des créations d’emplois sont des créations temporaires [CDD]. Face à l’incertitude sur leurs carnets de commandes, les entreprises ne veulent plus employer en CDI de peur de devoir garder des salariés dont elles n’ont plus besoin. Et elles multiplient le recours aux contrats courts. Quant aux personnes en CDI, si elles sont licenciées, elles vivent un drame, réel, car elles auront beaucoup de mal à retrouver un autre CDI. Dans le débat public, on insiste beaucoup sur ces victimes, visibles, mais on ne voit pas tous les autres, les chômeurs ou les titulaires de CDD.
Mais si vous facilitez la rupture des CDI, vous déstabilisez ces derniers pour faire de la place aux autres. Dur à accepter pour les intéressés !
Il faudrait accorder les « droits du grand-père » à tous ceux qui sont déjà titulaires d’un CDI, qui conserveraient donc leurs droits actuels. En revanche, les nouveaux entrants bénéficieraient du nouveau contrat unique. Les blocages sur ce débat viennent du fait que l’on assimile « contrat à durée indéterminée » à « emploi à durée indéterminée ». Par ailleurs, on sous-estime le fait qu’aujourd’hui, les titulaires d’un CDD sont considérés, par les banques ou les bailleurs, comme des populations à risque, ce qui limite leur capacité à consommer. Le contrat unique rendrait « solvable » une frange importante de la population.
En France, en particulier, ce genre de message a du mal à passer.
Les Français sont assez méfiants avec l’économie et avec le marché : seuls 36 % d’entre eux lui font confiance, pour 65 % des Allemands, 71 % des Américains et 74 % des Chinois. Beaucoup rêvent d’être fonctionnaires et peu de chercheurs ont envie de créer leur entreprise. Cela ne veut pas dire que les Français ne soient pas entrepreneurs. Il y a beaucoup de talents en France; par exemple, les étrangers nous disent que nos ingénieurs sont extrêmement bien formés. Mais il y a cette méfiance systématique vis-à-vis du marché, que je tente d’expliquer dans le livre.
Vous pointez aussi le fait que la France a été une économie planifiée, de l’entre-soi.
Il y a un peu de ça. Longtemps, il a été plus important de faire partie d’un certain réseau plutôt que de maîtriser le raisonnement économique qui a cours au FMI, à la Commission Européenne ou dans les autorités indépendantes (concurrence, télécoms, régulation bancaire, etc). En France, on pensait que l’on n’avait pas besoin de ça. On était une économie plus fermée, les décisions étaient essentiellement politiques. Cela n’a pas facilité le rapport à l’économie. Souvenons-nous que c’est François Mitterrand qui, en 1986, a arrêté le contrôle des prix. Alors que les autres pays l’avaient fait depuis très longtemps. Les grandes réformes de libéralisation de l’audiovisuel datent aussi de ce moment-là…
La création d’autorités indépendantes est toujours critiquée en France au nom de la perte de souveraineté…
A chaque présidentielle, le sujet revient et l’on critique la Banque centrale européenne, l’autorité de la concurrence… alors que c’est justement leur indépendance qui a nettement amélioré la qualité des décisions publiques dans leurs domaines en les protégeant des pressions politiques. Que les mouvements populistes soient sur cette ligne n’est pas très surprenant ; ce qui l’est davantage, c’est qu’en France même les partis modérés adoptent ce genre de critiques.
Vous dites que l’économie est une science consensuelle. On n’en a pas toujours l’impression quand on voit, par exemple, les débats sur l’euro, le marché du travail ou la gestion des finances publiques.
Les économistes ne sont pas d’accord sur tout et il y a de très vifs débats sur les sujets que l’on comprend mal. C’est heureux, car c’est le débat qui fait avancer les choses. Le désaccord fait partie de la science, pas seulement économique. Les réputations en recherche se construisent sur la base de la remise en cause de connaissances existantes. Mais les désaccords entre économistes sont relativement limités par rapport au spectre des opinions dans le débat public. Dans les conférences, dans les grandes revues scientifiques, je n’ai par exemple jamais entendu dire ou lu qu’on résoudra le réchauffement climatique sans une tarification étendue du carbone ; ou que partager l’emploi en crée ; ou encore qu’un marché du travail dual est bon pour l’économie.
Mais certains diront que l’important ce n’est pas l’organisation du marché du travail, mais le carnet de commande
Tous les économistes seront d’accord pour dire que le carnet de commande est important. A partir de là, la question qui se pose est celle de la relance budgétaire : faut-il la pratiquer pour compenser une croissance actuellement trop faible ? Sur ce point, les économistes ne sont pas d’accord car les théories sont ambigües et les données empiriques ne permettent pas de trancher. On sait qu’il ne faut pas trop réduire les déficits budgétaires quand les choses vont mal, ce qui peut freiner l’activité. A l’inverse, si l’on ne fait rien, on peut créer des problèmes de finances publiques. Actuellement, les pays d’Europe du Sud, ou le Japon, vivent avec des dettes très élevées, 240 % du PIB au Japon, et le supportent car les taux d’intérêt sont très bas et la dette est détenue dans le pays. Mais une crise de confiance peut survenir, qu’on ne peut absolument pas prédire. Car ces phénomènes, dits auto-réalisateurs, dépendent du comportement des gens.
Les économistes ne sont donc pas à l’aise avec les prévisions, ils sont bien meilleurs……pour expliquer ce qui s’est passé plutôt que pour prévoir ?
Oh, ça c’est la version pas très gentille (rires) ! En fait, nous savons identifier des facteurs propices aux crises, bancaires ou de dette souveraine. Mais de même que le médecin ne peut pas prédire le moment de l’infarctus, nous ne pouvons pas déterminer celui de la crise.
En quoi l’ouverture de l’économie à d’autres sciences sociales a –t-elle été positive?
Jusqu’à la fin du 19ième siècle, l’économie était une science sociale complètement intégrée aux autres sciences sociales. Adam Smith, qu’on dit économiste, était aussi un philosophe, un psychologue, sa Théorie des sentiments moraux est un livre aussi intéressant que La richesse des nations. Au 20ième siècle, l’économie s’est séparée, s’est construit sa propre identité, c’était une bonne chose. Mais du coup elle y a perdu de sa richesse, les apports de la psychologie, l’étude des comportements des individus et des groupes.
L’homme n’agit donc pas toujours de manière purement rationnelle ?
Effectivement, ce n’est pas toujours le cas. Ainsi, nous avons une préférence pour le présent qui nous fait remettre au lendemain différentes décisions (travail, épargne, rupture de dépendances). Nous souffrons des biais cognitifs décrits dans le livre. Nous ne donnons pas systématiquement la primauté à notre intérêt matériel. Un éclairage croisé est nécessaire pour mieux comprendre les interactions sociales et améliorer les politiques publiques. Il y a cinq ans, nous avons créé un institut pluridisciplinaire, l’Institute for Advanced Study in Toulouse. Il rassemble des chercheurs qui font de la biologie évolutionniste, du droit, de la science politique, de la sociologie, de la psychologie, de l’anthropologie. Par exemple, des économistes travaillent avec des biologistes pour essayer de comprendre l’altruisme : peut-il s’expliquer d’un point de vue de la sélection naturelle ? L’homme rationnel, s’il est vraiment égoïste, maximise son intérêt propre. Mais il arrive qu’on se comporte bien, gratuitement, avec des gens qu’on ne reverra jamais, sans chercher de contre-don. Pourquoi ? Les gens plus altruistes réussissent-ils mieux socialement et économiquement que les autres, et jusqu’à quel point ? Voilà le genre de choses que nous étudions.
Vous décrivez longuement le métier d’économiste
J’ai hésité à le faire par crainte de contribuer à la peopolisation actuelle des économistes. J’ai pris le risque car le travail de chercheur en économie est peu connu du grand public. L’économie n’a pas, et de loin, l’exactitude de la mécanique newtonienne, mais elle est une science : elle formule des hypothèses, alors critiquables et réfutables, utilise la logique pour déduire ses conclusions et teste les deux à l’aide de l’outil statistique. Tout cela est évalué par les pairs au niveau international.
Vous soulignez les risques de l’engagement de l’économiste dans la cité
Soit je prenais la défense de la profession en disant : « Voilà, nous sommes tous formidables. » Soit j’essayais de montrer cette profession avec ses qualités et ses défauts. C’est important : dans tout le livre, j’insiste plus généralement sur le fait que les gens réagissent tous à leurs incitations. Y compris les politiques. Pour ces derniers, c’est la prochaine élection qui compte, ce qui pousse au court-termisme. Je ne leur jette d’ailleurs pas la pierre, même si je suis souvent furieux contre certaines politiques. A leur place, j’en ferais peut-être autant… Mais la France est dans une situation paradoxale où l’on croit très fort à la toute-puissance de la politique et où, dans le même temps, on ne cesse de blâmer les individus qui en font.
Et pour les économistes, quelles sont les incitations, le pouvoir, l’argent?
Comme pour tout scientifique, avant tout leur curiosité intellectuelle, leur goût pour la connaissance et son partage. Mais certains ne sont pas insensibles à ces stimuli, ainsi qu'au prestige, à la célébrité, aux amitiés politiques, etc. Dans le livre, je recense les différentes tentations et donne quelques garde-fous.
En France, vous êtes étiqueté comme « libéral »?
Oui, mais les personnes qui disent cela souvent ne savent pas ce qu’est le libéralisme, qui n’est pas du tout le laissez-faire, mais la responsabilisation des acteurs économiques pour les inciter à contribuer au bien commun. Les régulations sont la main visible du marché au service de l'intérêt général. Elles représentent le cœur de mes recherches. A l’étranger, je suis vu comme quelqu’un de gauche, très régulateur ; en France, comme un ultra-libéral. Cette catégorisation est erronée parce que trop simpliste. Les économistes doivent apporter une vision qui vient de leur recherche et se construire sans préjugés.
Vous insistez sur la réforme de l’Etat. Comment s’y prendre ?
Certains prônent le maintien du statu quo, d’autres préconisent au contraire un Etat minimaliste se concentrant sur les fonctions régaliennes. Ces visions ne sont pas les miennes. L’Etat moderne doit fixer les règles du jeu et intervenir pour pallier les défaillances du marché et non s’y substituer. Il doit s’interroger sur chacune de ses politiques : sert-elle l’intérêt public ? Si oui, pourrait-elle être fournie par une autre branche du secteur public ou par le secteur privé ? La conception de l’Etat a beaucoup changé. Autrefois, on le voyait comme un pourvoyeur d’emplois. C’est une vision erronée : quand on crée un emploi public, l’argent vient d’ailleurs, il faut lever un impôt, prélever une ressource auprès des agents économiques privés, les citoyens et les entreprises, ce qui limite d’autant leur capacité à consommer ou investir.
L’emploi public est tout de même utile ?
Oui, mais c’est une notion différente : la finalité de l’emploi public c’est d’offrir un service au citoyen, pas de créer des emplois, sinon nous n’aurions plus de chômage en France ! Notre pays a envie de conserver un système de protection sociale important, et c’est possible, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit systématiquement assuré par des emplois publics. On peut recourir à des délégations de service public, à des emplois contractuels. Il faut suivre l’exemple des pays scandinaves : ils sont parvenus à faire les réformes à travers un paquet unique, ce qui diminue le poids des lobbies. Il faut aussi un soutien bipartisan (gauche-droite) pour garantir la pérennité des réformes.
Vous affirmez que le chômage, en France, correspond à un choix de société. Une provocation?
Le chômage ne résulte pas d’un phénomène aléatoire, ou d’un manque de chance. Depuis 30 ou 40 ans, il est structurel et pas seulement conjoncturel, il n’est jamais descendu en dessous de 7 %. Aujourd’hui, malgré la baisse de l’euro, des taux d’intérêt et du prix du pétrole, il ne se résorbe toujours pas. Ce n’est pas un hasard si les autres pays d’Europe du Sud qui, à l’origine, possèdent des institutions similaires à celles de la France, pâtissent aussi d’un taux de chômage élevé. Et ce n’est pas un hasard si les pays d’Europe du Nord, l’Allemagne, l’Angleterre, n’en souffrent pas. Parler de « préférence » pour le chômage ne veut pas dire que l’on a envie d’avoir du chômage, mais que cela correspond à un choix. Il n’y a pas que la question du chômage : beaucoup de salariés sont frustrés de devoir rester dans un emploi face à un employeur empêché de restructurer, avec comme conséquence une ambiance générale qui se dégrade et une productivité en berne. Le chômage quant à lui crée une perte pour les finances publiques : des cotisations sociales qui ne sont plus encaissées et une politique de l’emploi très coûteuse, à défaut d’être efficace.
Ce choix, il résulte de quoi ?
Le débat récent en France s’est concentré essentiellement sur le licenciement, mais il y a beaucoup d’autres facteurs, l’éducation, la formation professionnelle elle coûte 31 ou 32 milliards d’euros par an pour un résultat très médiocre, le choix de la redistribution par un salaire minimal plus élevé qu’à l’étranger plutôt que par l’impôt. Il faut toute une série de réformes. Par rapport aux Allemands ou aux pays scandinaves, on en est très loin.
Quelles sont vos propositions ?
Avec Olivier Blanchard [ancien économiste en chef du FMI], nous avons proposé la création d’un bonus-malus pour responsabiliser l’entreprise. Actuellement, celles qui licencient pas ou peu, paient des cotisations d’assurance-chômage qui servent à financer des prestations versées à des salariés licenciés par d’autres entreprises. Le bonus-malus change la logique : moins les entreprises licencient, moins elles paient d’assurance-chômage.
Le système est donc fait pour s’équilibrer ?
Oui, il ne s’agit pas d’une taxe nouvelle, mais d’incitations mieux construites.
Et la protection du salarié ?
Actuellement les CDD ne sont pas du tout protégés. Demain la protection serait la même pour tous ; elle passerait par les indemnités, l’assurance chômage et le bonus-malus ; et non par une intervention du juge qui n’a pas les moyens de dire si tel ou tel licenciement est justifié. Son rôle serait cantonné à la sanction des abus (licenciement d’une femme enceinte, par exemple).
Dans Le Monde, vous vous étiez prononcé en faveur de la première version de la loi El Khomri ? Que dites-vous de sa version modifiée ?
Je ne l’ai pas vue (rires) !
Vous êtes sévère avec les résultats de la Cop 21. Pourquoi ?
Actuellement, il n’y a pas d’engagement ferme des Etats, pas de traité. Aucun politique n’est rentré dans son pays en disant : « Maintenant, on va souffrir un peu pour améliorer le climat. » Partout, on continue d’investir dans les centrales à charbon. La victoire, c’est que 196 pays se sont mis d’accord sur un objectif, mais à partir du moment où l’Arabie saoudite et le Venezuela signent, vous savez que vous n’aurez pas de taxation du carbone.
Pour vous, elle est indispensable?
Oui, c’est l’idée du pollueur-payeur, de la responsabilisation, comme pour le marché du travail. Il faut fixer un prix du carbone mondial. Il en existe un peu partout, mais ils sont trop faibles, sauf en Suède. Les experts le chiffrent à 50 euros la tonne de CO2, il faudra sûrement ajuster. Tous les pays devront payer, y compris ceux du Sud. Parce que leur développement est phénoménal, donc très polluant ; parce que sinon, les pays riches iront encore davantage produire dans le sud. Mais, parallèlement, il faut créer un vrai fonds pour aider ces pays les plus pauvres.
Les taux d’intérêts très bas sont-ils annonciateurs d’une « stagnation séculaire » ?
Faisons-nous face à une stagnation séculaire c’est- à-dire le maintien, en période longue, de taux d’intérêts et d’une croissance faibles ou vivons-nous tout simplement les conséquences temporaires de la crise financière mondiale et d’autres chocs ? Certains facteurs laissent penser que les taux bas d’aujourd’hui sont durables : la démographie, la croissance des inégalités (les plus riches épargnent plus, ce qui fait monter le prix des actifs et donc baisser les taux d’intérêt). La stagnation est possible, mais les économistes ne sont pas en mesure d’avoir des convictions précises là-dessus.
L’économie numérique peut-elle nous sauver ?
Elle produit des choses remarquables. Dans mon livre, je décris les plateformes bifaces, ces marchés où un intermédiaire permet à des acheteurs et des vendeurs d’interagir. Trois des cinq plus grandes entreprises mondiales (Apple, Google, et Microsoft) sont des plateformes multifaces. Les Français doivent comprendre ces nouveaux modèles économiques pour mieux les adopter et mieux les réguler à la fois. Le digital modifie la chaine de valeur, remet en question l’organisation de secteurs, de la société elle-même. Prenons le cas de l’assurance : aujourd’hui, les concurrents d’Axa ou d’Allianz s’appellent Google ou Facebook, parce qu’ils en savent dix fois plus sur vous que votre compagnie d’assurance. Il leur est assez facile de faire des offres d’assurance santé ciblées sans avoir accès au moindre dossier médical. La génétique aussi pose problème : on peut prédire dès la naissance les pathologies dont vous pourriez souffrir ! Difficile d’imaginer toutes les conséquences de cela, mais c’est un vrai sujet de préoccupation.
Quelle est la réponse des économistes?
On doit vous assurer contre ce dont vous n’êtes pas responsable : vous ne l’êtes pas de vos gênes. Si vous avez un cancer ou une maladie de longue durée, vous devez être assuré pleinement, c’est pour cela que dans tous les systèmes, publics, comme en France, ou privés, comme en Allemagne, en Suisse ou aux Pays-Bas, on vérifie qu’il n’y a pas de discrimination, que les assureurs n’offrent pas des primes très avantageuses à ceux qui sont en bonne santé et imposent des tarifs énormes aux autres. Si les Google ou les Facebook s’intéressent à ce marché, ils doivent être soumis aux mêmes obligations que les acteurs classiques.
La France a les talents pour être dans le peloton de tête de l’économie du 21ième siècle. Nous n’y sommes pas car nous subissons les évolutions, notre logiciel intellectuel nous faisant encore trop regarder vers le passé.
Quelle question économique de fond la présidentielle de 2017 devrait-elle trancher ?
Toutes les questions du livre et plus encore, car le livre ne comporte que 17 chapitres ! Plus sérieusement, nos sociétés doivent se confronter aux sujets qui menacent la pérennité de notre système social. L’un des messages de mon livre est qu’il n’y a pas de fatalité aux maux dont souffre notre pays. Il existe des solutions au chômage, au réchauffement climatique, à la déliquescence de la construction européenne. Mais il faut anticiper les évolutions. Prenons le chômage. Avec le numérique, les métiers évoluent très vite, le vôtre, le mien : aujourd’hui, un prof d’Harvard peut déjà faire un cours online à ma place. Face à cette révolution, il n’y aura plus beaucoup d’entreprises pour embaucher avec le CDI actuel. Nous connaissons actuellement une crise des réfugiés, mais nous aurons une crise des migrants liée au réchauffement climatique. Sera-t-on en mesure de créer des emplois pour ces migrants ? Ils sont une chance pour un pays, pour sa démographie, sa Sécurité sociale, son système de retraites, si on peut leur offrir un travail. Mon livre parle aussi beaucoup de l’emploi à l’ère du numérique: allons-nous vers l’ « Uberisation », vers la fin du salariat ? De l’emploi tout court ? La question de la fuite des cerveaux se pose aussi: les gens qui créent les nouvelles entreprises vont-ils partir à l’étranger ? Il faut arriver à discuter de tous ces sujets, en s’attachant au fond, pas à des marqueurs.
C’est-à-dire ?
Je veux parler de certains tabous qui empêchent de débattre. Par exemple, l’absence de sélection à l’université est un marqueur pour certains. Or elle est un facteur d’inégalités gigantesque, elle créé de la sélection par l’échec. Même raisonnement pour ceux qui affirment que toutes les universités doivent être de qualité égale. C’est un marqueur qui bloque les évolutions nécessaires. Les élites s’en moquent car leurs enfants ne fréquentent pas l’université, mais les grandes écoles. J’ai été formé par celles-ci, je les apprécie, mais l’avenir du pays se joue en grande partie dans les universités. Dans ce bâtiment, les chercheurs sont convaincus qu’il faut que l’université offre des services de qualité, qu’il ne faut pas privilégier une petite minorité venant des grandes écoles. Je note que l’on commence à débattre de ces questions sur l’université, même si c’est insuffisant. Je note que l’on a commencé à débattre de la réforme du marché du travail, même si elle a été globalement rejetée au niveau politique et qu’elle ne sera adoptée que sous une forme complétement édulcorée. Il ne faut pas attendre de crise économique majeure pour agir, il faut anticiper. Sinon, on réagit à la hâte et de façon brutale.
Les pays scandinaves, l’Allemagne, ont su anticiper ?
Attention, dans ces pays, les grandes réformes ont toujours été faites dans des situations difficiles. La Canada avait un chômage élevé, des finances publiques qui dérapaient, la Scandinavie a connu des crises bancaires, L’Allemagne devrait gérer la réunification et une démographie défavorable. Mais ils n’ont pas attendu la dernière minute pour décider et agir.
En France, on attend le dernier moment ?
Nous sommes depuis longtemps dans le déni! Si mon livre pouvait permettre de dépasser certains blocages, si dans 10 ans, un jeune doctorant venait me voir en disant que cette lecture lui a donné l’envie de la recherche, ce serait formidable.